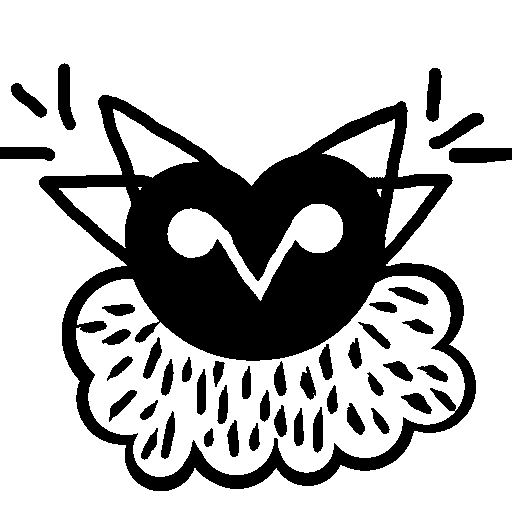みちの < MARCHER AU BORD DE LA FAILLE



Il y a maintenant plus de douze ans, en mars 2011, avait lieu au Japon une triple catastrophe – un tremblement de terre, un tsunami, un accident nucléaire majeur – dont les échos se font encore sentir. Passé dans la généalogie des grandes catastrophes, destinées, comme celle de Tchernobyl, à marquer notre temps, cet événement a imposé, jusqu’à ce jour, des recalibrages majeurs de nos manières d’envisager les risques technologiques en les articulant aux mouvements de la planète.
Il s’agit ici de concevoir un dispositif de recherche-création susceptible de rendre compte de la complexité de ce qui est toujours en train de se passer. Le problème posé – la triple catastrophe du 11 mars 2011 – concerne en effet l’ensemble de la société civile, les chercheurs et les artistes (nombreux et qui se sont mobilisés très rapidement pour penser et figurer la catastrophe), les spécialistes et les profanes. Il exige, de par sa forme et ses impacts, d’être traduit en idées et concepts mais aussi en récits, sons et gestes, en science et en fictions. Cette exigence, croyons-nous, s’applique à tout ce qui est vécu sur le mode de l’incertitude, de la peur et de la menace. Les catastrophes, parce qu’elles génèrent des controverses scientifiques et des disputes sociales, ne font jamais l’objet d’un savoir stable, mais processuel1. Elles participent à la reconfiguration des savoirs, des légitimités et des régimes d’intelligibilité et, de ce fait, contribuent aux équilibres dynamiques qui font société. Elles posent problème et leurs prises en charge – complexe s’il en est – s’effectuent aussi bien par des prises rationnelles que fictionnelles, scientifiques qu’artistiques, conceptuelles que sensibles. En outre, l’idée d’un dispositif de « recherche-création » décalque en quelque sorte l’appréhension locale de l’événement catastrophique et de son devenir.
Anticiper ce qui pourrait nous arriver un jour – sur un mode autre que celui qui sert à anticiper les gestions de risque. Comment et jusqu’où étendre le concernement ?
En partenariat avec Sophie Houdart, Anthropologue, directrice de recherche au CNRS, au Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative, Alexandre Schubnel, directeur de recherche au CNRS, professeur attaché au Laboratoire de Géologie de l’ENS, F93, Centre de culture scientifique et technique, Montreuil (93).